
Actus & Blog

Le référé expertise judiciaire est prévu à l’Article 145 du code de procédure civile.
Il permet le recours à un expert pour établir ou conserver des preuves dont peut dépendre l’issue d’un litige. Il permet d’obtenir une analyse précise d’un état de fait existant.
Pour ce faire, vous devez assigner les adversaires potentiels identifiés devant le tribunal judiciaire compétent en fonction de votre dossier. La rédaction de l’assignation est une étape cruciale. Vous devez démontrer le bien fondé de votre demande et son utilité pour que le juge vous accorde l’expertise.
Attention, il ne s’agit pas d’une formalité car si une condition fait défaut le juge vous refusera l’expertise.
Dès lors il est conseillé de faire appel à un avocat qui pourra réaliser l’assignation, faire signifier cette assignation par voie d’huissier et vous représenter à l’audience de référé.
Point de vigilance : à l’audience veillez à vous présenter avec l’ensemble des seconds originaux idoines ainsi qu’un exemplaire physique complet de votre assignation.
Le juge rendra sa décision rapidement dans un délai moyen d’un mois en fonction des tribunaux.
A partir de la réception de l’ordonnance de référé faisant droit à l’expertise, en tant que demandeur, vous devez procéder au dépôt d’une consignation. En effet le juge aura très probablement fixé le paiement d’une consignation à la charge du demandeur. Cela est logique, car le défaut de consignation entraine la caducité de l’ordonnance et la perte de la procédure en cours. Il apparait évident de ne pas laisser ce paiement à la charge d’un éventuel adversaire qui n’aura aucun intérêt à payer une consignation pour obtenir les preuves de sa condamnation probable…
La consignation, point de départ de la mission de l’expert
Une fois l’expert désigné par le juge, et sa mission précisée, l’expert ne commence celle-ci, qu’après le paiement d’une provision de consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa.
Importance de la promptitude pour le dépôt de la consignation
Il est important de savoir comment procéder au paiement de la consignation car l’article 271 du CPC prévoit que le non-respect du délai imparti par le juge entrainera à la caducité de la désignation d’expert.
Modalité pratique de règlement de la consignation
Le paiement est à régler par virement, chèque de banque, chèque bancaire du client ou chèque CARPA au service de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire concerné.
Attention : pour les virements, certaines étapes sont obligatoires afin de permettre l’identification et l’enregistrement effectif du paiement. Notamment, la communication préalable de la décision au service de la régie.
Pour l’obtention de ses coordonnées bancaires, il faut contacter directement le service de la régie concerné.
3 options s’offrent à vous :
- Vous rendre sur place pour obtenir le RIB nécessaire pour procéder à votre paiement.
- Appeler le service aux fins d’obtention de leur adresse courriel et de la procédure à suivre pour consigner les sommes
- Ecrire un mail au service, si vous êtes en possession de leur adresse courriel
A cet effet nous vous communiquons ci-dessous, quelques adresses et infos utiles sur les régies pour la zone parisienne et les alentours :
REGIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS :
· Contact : 01 44 32 59 30/ 01 87 27 98 58
· Mail : regie1.tj-paris@justice.fr
REGIE COUR D’APPEL PARIS :
· Contact : 01.44.32.51.23
· Mail : regie.ca-paris@justice.fr
REGIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX :
· Mail : regie1.tj-meaux@justice.fr
REGIE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY :
· Tél : 01.60.76.80.08
Vous avez un différend avec une entreprise ? Notre cabinet peut vous accompagner dans l’anticipation du procès via le référé expertise et la négociation d’une solution amiable. Toute expertise ne conduira pas nécessairement à un procès mais vous donnera des éléments de négociation d’une solution amiable équilibrée.
Notre cabinet intervient en contentieux des affaires complexes et en matière de contentieux immobilier de la construction.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

THOMSON REUTERS contre ROSS Intelligence : Victoire significative du droit d’auteur contre l’intelligence artificielle.
Le 11 février 2025, la Cour de l’Etat du Delaware aux États-Unis a rendu une décision importante opposant les sociétés Thomson Reuters et Ross Intelligence (Ross). Voir ici la décision complète.[1]
I. Présentation des parties et enjeu du litige
Les Parties.
Thomson Reuters, est un des trois premiers groupes mondiaux d’édition. C’est une agence de presse canado-britannique et une société d’édition professionnelle fournissant des services de veille financière et juridique. Le groupe détient notamment l’agence de presse renommée, Reuters. Dans le cadre de ses activités, Thomson Reuters réalise des « headnotes » qui sont des résumés de points clés d’une décision de jurisprudence (« judicial opinions »).
Ross, quant à elle, est une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au domaine juridique. Elle a développé une plateforme d’IA capable d’analyser et de rechercher des informations juridiques de manière automatisée et a souhaité utiliser les headnotes de Westlaw, l’une des plus importantes plateformes de recherche juridique détenue par Thomson Reuters.
Les enjeux
La bataille judiciaire entre Thomson Reuters et Ross trouve son origine dans le refus de Thomson Reuters d’accorder une licence d’exploitation sur sa plateforme de recherches juridiques Westlaw à Ross, la considérant comme une entreprise concurrente.
Or, l’intelligence artificielle juridique a besoin d’accéder à une large base de données pour fonctionner efficacement. Face à cette impasse, Ross a eu recours à un tiers pour générer des ‘‘bulk memos’‘—c’est-à-dire des synthèses juridiques en masse—destinées à entraîner son intelligence artificielle. Toutefois, certains de ces ‘‘bulk memos’‘ auraient été directement dérivés des ‘‘headnotes’‘ de Westlaw, propriété de Thomson Reuters, ce qui constituerait une violation des droits d’auteur de ce dernier. C’est en découvrant cela que Thomson Reuters a poursuivi Ross en justice.
L’affaire opposant ces deux entreprises soulevait trois questions principales :
- Les “headnotes” sont-ils protégés par le « Copyright »[2] (équivalent américain du droit d’auteur en France[3]) ?
- Si oui, la startup ROSS a-t-elle utilisé ces “headnotes” de manière illicite ?
- S’il s’agit d’une copie d’une œuvre protégée, la notion de « fair use » – une exception au “Copyright” – est-elle applicable à ce cas ?
II. Le principe de fonctionnement du “Copyright” américain
Le “Copyright” a pour but de protéger les œuvres originales et les auteurs de ces œuvres contre toute utilisation non autorisée.
Le 11 février 2025, la Cour de l’Etat du Delaware aux États-Unis a rendu une décision importante opposant les sociétés Thomson Reuters et Ross Intelligence (Ross).
Présentation des parties et enjeu du litige
Les Parties.
Thomson Reuters, est un des trois premiers groupes mondiaux d’édition. C’est une agence de presse canado-britannique et une société d’édition professionnelle fournissant des services de veille financière et juridique. Le groupe détient notamment l’agence de presse renommée, Reuters. Dans le cadre de ses activités, Thomson Reuters réalise des « headnotes » qui sont des résumés de points clés d’une décision de jurisprudence (« judicial opinions »).
Ross, quant à elle, est une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au domaine juridique. Elle a développé une plateforme d’IA capable d’analyser et de rechercher des informations juridiques de manière automatisée et a souhaité utiliser les headnotes de Westlaw, l’une des plus importantes plateformes de recherche juridique détenue par Thomson Reuters.
Les enjeux
La bataille judiciaire entre Thomson Reuters et Ross trouve son origine dans le refus de Thomson Reuters d’accorder une licence d’exploitation sur sa plateforme de recherches juridiques Westlaw à Ross, la considérant comme une entreprise concurrente.
Or, l’intelligence artificielle juridique a besoin d’accéder à une large base de données pour fonctionner efficacement. Face à cette impasse, Ross a eu recours à un tiers pour générer des ‘‘bulk memos’‘—c’est-à-dire des synthèses juridiques en masse—destinées à entraîner son intelligence artificielle. Toutefois, certains de ces ‘‘bulk memos’‘ auraient été directement dérivés des ‘‘headnotes’‘ de Westlaw, propriété de Thomson Reuters, ce qui constituerait une violation des droits d’auteur de ce dernier. C’est en découvrant cela que Thomson Reuters a poursuivi Ross en justice.
L’affaire opposant ces deux entreprises soulevait trois questions principales :
- Les “headnotes” sont-ils protégés par le « Copyright » (équivalent américain du droit d’auteur en France ) ?
- Si oui, la startup ROSS a-t-elle utilisé ces “headnotes” de manière illicite ?
- S’il s’agit d’une copie d’une œuvre protégée, la notion de « fair use » – une exception au “Copyright” – est-elle applicable à ce cas ?
Le principe de fonctionnement du “Copyright” américain
Le “Copyright” a pour but de protéger les œuvres originales et les auteurs de ces œuvres contre toute utilisation non autorisée.
Les judicial opinions, en droit américain (décisions de jurisprudence) relèvent du domaine public et ne sont pas protégeables par le “Copyright”.
En revanche, les synthèses de ces décisions rédigées par des experts résultent d’un travail original impliquant une analyse, un effort intellectuel et un investissement financier pour leur réalisation. Ainsi, les ‘‘headnotes’‘, en tant que résumés apportant une valeur ajoutée sont protégeables par le “Copyright”.
C’est cette distinction qu’a suivie le juge Bibas dans cette affaire. Il a estimé que la modification d’une ‘‘judicial opinion’‘ implique des choix subjectifs de l’auteur, et constitue une manière originale de synthétiser les décisions de justice, les rendant protégeables par le “Copyright”.
Le juge a ensuite considéré que les ‘‘bulk memos’‘ utilisés par Ross ressemblaient davantage aux ‘‘headnotes’‘ de Westlaw qu’aux ‘‘judicial opinions’‘ en accès libre. Dès lors, il a conclu à une utilisation non autorisée de contenus protégés par le ‘‘Copyright’‘, ce qui constitue une violation en l’absence d’une exception légitime au copyright, justifiant cette utilisation.
Le refus d’application de l’exception de « fair use » et les apports de la décision
Tout comme le droit français prévoit des exceptions au droit d’auteur, le droit américain prévoit des exceptions au ‘‘Copyright’‘, notamment celle du ‘‘fair use’‘.
L’application de cette exception repose sur quatre critères[1] :
1. Le but et la nature de l’utilisation (usage commercial ou non, transformation du contenu) ;
2. Le degré de créativité de l’œuvre originale ;
3. La quantité et la substantialité des parties empruntées à l’œuvre originale ;
4. L’impact de l’utilisation sur le marché potentiel ou la valeur de l’œuvre originale.
Dans cette affaire, deux critères posaient des difficultés
– ‘‘Le critère de la transformation’‘ : Le tribunal a estimé que Ross n’apportait pas d’interprétation nouvelle aux ‘‘headnotes’‘ de Westlaw, mais utilisait ces contenus pour créer un service concurrent.
– ‘‘L’impact sur le marché ou la valeur de l’œuvre originale” : L’exploitation des ‘‘headnotes’‘ par Ross risquait de nuire directement à Westlaw.
Ces deux éléments ont conduit le tribunal à refuser d’appliquer l’exception du ‘‘fair use’‘. Ainsi, le ‘‘Copyright’‘ s’appliquait bien aux ‘‘headnotes’‘, et Ross ne pouvait pas se prévaloir d’une exception pour justifier son usage.
Apports majeurs de la décision et conseils clés pour les éditeurs de solution d’IA
Cette décision représente une victoire pour les éditeurs de contenus juridiques, qui voient leur protection renforcée contre l’exception du ‘‘fair use’‘. Jusqu’à présent, cette exception était fréquemment invoquée par les éditeurs d’IA juridique (LegalTech d’IA) pour justifier l’exploitation de contenus protégés.
En revanche, ce jugement limite les perspectives de développement des éditeurs d’IA juridiques.
Les startups du secteur sont désormais face à deux alternatives :
– Obtenir une licence payante pour utiliser les bases de données juridiques existantes ;
– Développer leurs propres synthèses juridiques, ce qui représente un investissement conséquent.
Analyses supplémentaires sur la responsabilité de Legal Ease, le tiers ayant fourni les “bulk memos” :
Legal Ease semblait détenir un abonnement lui permettant d’avoir accès au contenu de Westlaw et de le partager avec Ross Intelligence. Si Legal Ease n’a pas été poursuivie dans le cadre du présent litige, c’est parce qu’un différend l’opposant à Thomson Reuters avait préalablement été réglé dans le cadre d’un accord amiable. Cet accord amiable stipulaitt une interdiction à LegalEase de reproduire le contenu de Westlaw et de partager ses codes d’accès[1]. Cet accord a probablement renforcé la position de Thomson Reuters dans son action contre Ross Intelligence.
Nos conseils: Conseil n°1 : Licenciés et sous-licenciés, attention à la garantie de jouissance paisible
Veillez impérativement à inclure une clause de jouissance paisible, ou de garantie d’éviction, dans vos contrats de licence d’utilisation de contenus.
En effet, la nature exacte de la relation entre Ross Intelligence et Legal Ease n’est pas précisée. Ainsi, la question se pose de savoir si l’accord conclu entre ces deux parties comprenait, au profit de Ross Intelligence, une garantie contre toute contrefaçon ou violation de droits d’auteur, sécurisant l’usage des “bulk memos”.
Une telle garantie, classique en matière de licence d’utilisation de contenus, permet au licencié (ou au sous-licencié légitime) — ici, Ross Intelligence — d’appeler en garantie l’éditeur, ou le licencié
principal — ici, Legal Ease — afin d’obtenir la prise en charge des frais de justice liés à une action en contrefaçon.
D’ailleurs, pour ce type de clause particulièrement sensible, notre cabinet d’avocats veille systématiquement, lorsqu’il accompagne un client face à un éditeur de logiciel, à prévoir que toute transaction ou accord amiable avec un tiers détenteur légitime des droits ne peut intervenir sans l’accord préalable — ou l’information — du licencié ou du sous-licencié concerné.
Conseil n°2 : éditeurs de contenus encadrez les sous-licences
Interdisez, autant que possible, les sous-licences dans vos contrats de licence d’utilisation de contenus. Si vous les autorisez, encadrez-les strictement, en précisant notamment les conditions de leur octroi et les modalités de leur usage.
Il est également essentiel de stipuler clairement que toute violation contractuelle ou atteinte aux droits d’auteur donnera lieu à des poursuites judiciaires.
Conclusion
L’affaire Thomson Reuters c/ Ross Intelligence illustre les tensions croissantes entre la protection des bases de données et l’innovation technologique dans le domaine juridique. Elle souligne la nécessité pour les startups d’IA de repenser leurs modèles d’entraînement et de mieux négocier les contrats d’utilisation avec les éditeurs de contenus, pour éviter des litiges similaires.
Vous êtes une legaltech, une start-up IA ou un acteur bancaire en pleine croissance ?
Le droit est un levier de votre développement.
Nous accompagnons les entreprises innovantes en France et à l’international pour sécuriser leurs contrats, protéger leurs actifs et anticiper les risques.
Discutons ensemble de solutions concrètes à vos enjeux juridiques.

L’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, encadrée par la loi JOP 2024, soulève des questions cruciales en matière de protection des données personnelles. Autorisée jusqu’au 31 mars 2025 dans des lieux spécifiques à risque, cette technologie est testée par des entités comme la RATP et la SNCF pour des cas d’usage précis tels que la détection d’objets abandonnés ou la gestion des mouvements de foule. Mais quels sont les enjeux juridiques et éthiques associés à ces expérimentations ?
Un cadre légal strict
La loi JOP 2024, accompagnée de ses décrets d’application, fixe un cadre légal rigoureux pour les expérimentations de vidéoprotection algorithmique. Les systèmes déployés ne doivent en aucun cas utiliser des technologies d’identification biométrique, telles que la reconnaissance faciale, conformément à l’interdiction légale en vigueur. Les Délégués à la Protection des Données (DPO) jouent un rôle essentiel en évaluant les Analyses d’Impact sur la Protection des Données (AIPD), formant les opérateurs et collaborant étroitement avec la CNIL pour garantir une utilisation éthique et conforme des outils.
Rôle central des DPO
Les DPO sont au coeur de ces expérimentations, assurant que chaque étape respecte les normes de protection des données. Leur mission inclut l’évaluation des risques potentiels, la formation des opérateurs sur les bonnes pratiques et la collaboration avec la CNIL pour s’assurer que les systèmes de vidéoprotection algorithmique respectent les droits des individus. De plus, un comité de pilotage doit soumettre des rapports réguliers à la CNIL, garantissant une transparence et une responsabilité accrues tout au long du processus.
Informer et protéger les usagers
Pour informer les usagers, la RATP et la SNCF ont développé un pictogramme innovant, distinct de celui utilisé pour la vidéoprotection classique. Ce pictogramme vise à sensibiliser le public à la présence de ces technologies, tout en respectant leur droit à l’information. Les premières expérimentations, réalisées lors d’événements tels que le match PSG-OL, illustrent l’importance de cette communication claire et transparente pour maintenir la confiance du public.
En conclusion, la vidéoprotection algorithmique, bien que prometteuse, doit être déployée avec une vigilance accrue pour protéger les données personnelles.
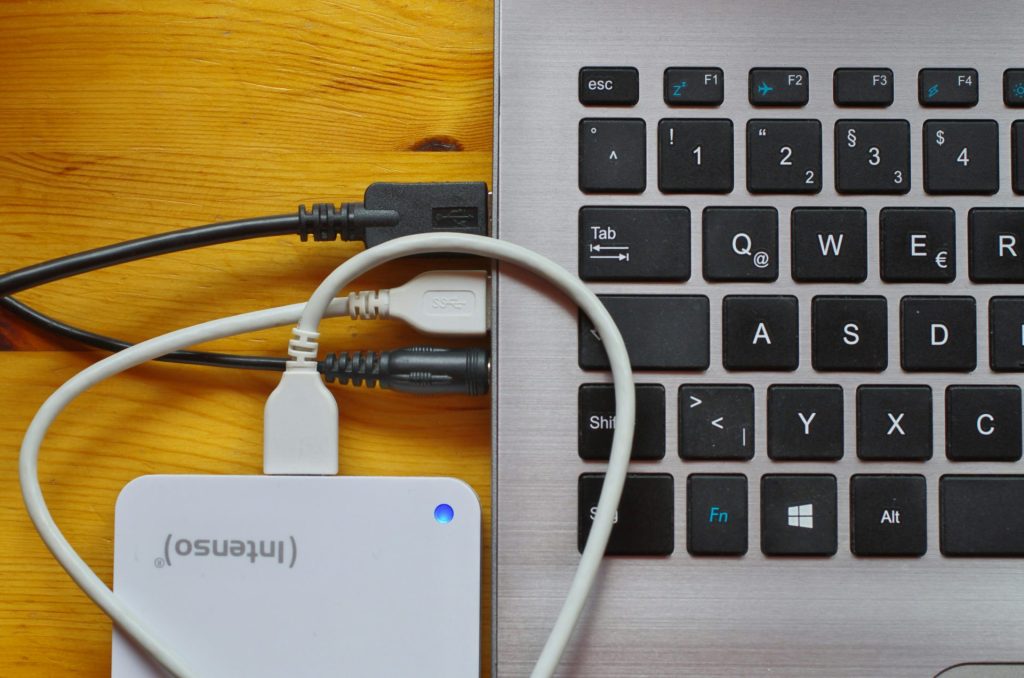
La confidentialité est un pilier fondamental de la procédure de conciliation, couvrant tant la décision d’ouverture que l’existence et le contenu de cette procédure. La Cour de cassation a récemment renforcé cette notion par un arrêt du 3 juillet 2024, apportant des précisions sur son étendue.
L’importance de la confidentialité en conciliation
La procédure de conciliation, régie par l’article L. 611-15 du Code de commerce, vise à préserver la confidentialité de toutes les informations relatives à son ouverture, son existence et son contenu. Cette confidentialité est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. Par exemple, dans une affaire récente, une société en redressement judiciaire a obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cependant, une banque a déclaré cette société en défaut à la Banque de France, entraînant une dégradation de sa cotation. La société a alors invoqué la confidentialité de la procédure pour contester cette déclaration.
Les implications légales de la confidentialité
Selon l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas mentionné, la société a assigné la banque en référé pour obtenir la main levée de l’inscription de défaut et la réparation de son préjudice. La Cour de cassation a finalement annulé l’arrêt de la cour d’appel, affirmant que l’ouverture d’une procédure de conciliation constitue une information confidentielle que la banque ne pouvait utiliser pour justifier une déclaration de défaut, causant ainsi un trouble manifestement illicite.
Conseils pour les entreprises en conciliation
Pour les entreprises engagées dans une procédure de conciliation, il est essentiel de comprendre l’étendue de la confidentialité. Toute divulgation non autorisée de l’existence ou du contenu de cette procédure peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Il est donc crucial de veiller à ce que toutes les parties impliquées respectent strictement cette confidentialité pour éviter des litiges potentiels et protéger les intérêts de l’entreprise.
En résumé, la confidentialité de la procédure de conciliation, telle que définie par l’article L. 611-15 du Code de commerce, est essentielle et doit être scrupuleusement respectée. L’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 renforce cette obligation et clarifie les conséquences d’une violation de cette confidentialité. Pour toute entreprise en difficulté, il est impératif de s’assurer que cette règle est bien comprise et appliquée par toutes les parties concernées.
Cass. com., 3 juill. 2024, n° 22-24.068, B+L

La double vie des avocats startupers »

Renonciation à succession : comprendre les enjeux et démarches ! Renoncer à une succession est une décision lourde de conséquences, souvent motivée par des dettes importantes du défunt ou des conflits familiaux. Un héritier dispose de quatre mois après le décès pour prendre cette décision, selon l’article 780 du Code civil. Passé ce délai, il pourrait être contraint d’accepter la succession, même de manière tacite. La renonciation doit être formellement déclarée devant un notaire ou un tribunal pour être juridiquement valide. Cette démarche est irrévocable, sauf en cas de vices du consentement comme l’erreur ou le dol. En renonçant, l’héritier n’est plus redevable des droits de succession, mais sa part est redistribuée, ce qui peut augmenter la charge fiscale des autres héritiers. Si tous les héritiers renoncent, la succession est déclarée vacante et les biens sont dévolus à l’État après apurement des dettes. Le notaire joue un rôle crucial en guidant l’héritier à travers la procédure, s’assurant que toutes les formalités sont respectées et que l’héritier comprend les implications de sa décision. #DroitDesSuccessions #Renonciation #Héritage

Les célèbres chaussures de luxe à semelle extérieure rouge de Christian Louboutin sont bien plus qu’une simple signature esthétique. La Cour d’appel de Paris a récemment confirmé l’originalité et la protection juridique de ces créations emblématiques dans une affaire de contrefaçon. Cette décision renforce la position de Louboutin en tant que créateur unique dans le monde de la mode.
L’originalité des créations Louboutin
La maison Louboutin a su démontrer l’originalité de ses créations, notamment à travers des modèles de sandales, d’escarpins et de semelles qui se distinguent par des caractéristiques uniques. Par exemple, une paire de sandales à talon aiguille a été reconnue pour sa plateforme en cuir verni et ses brides distinctives, tandis qu’une semelle épaisse et incurvée a été saluée pour sa conception innovante. Ces éléments ne sont pas de simples reproductions d’un fonds commun, mais bien des œuvres originales éligibles à la protection du droit d’auteur.
La protection de la marque de position
En plus de la reconnaissance de l’originalité de ses modèles, Louboutin a également défendu avec succès sa marque de position, la célèbre « semelle rouge ». La Cour a jugé que même si la société Otalons.com n’avait pas entièrement recouvert la semelle de rouge, l’utilisation partielle suffisait à créer un risque de confusion et à porter atteinte à la renommée de la marque. Cette décision souligne l’importance de la protection des marques de position dans le secteur de la mode.
Les conséquences juridiques de la contrefaçon
La société Otalons.com a été condamnée à verser des dommages-intérêts substantiels à Christian Louboutin et à sa société. En effet, elle devra payer un total de cent soixante mille euros pour les préjudices moral et patrimonial subis. Cette sanction financière illustre la gravité des actes de contrefaçon et la détermination de Louboutin à protéger ses créations contre toute imitation non autorisée.
Cette affaire met en lumière l’importance de la protection de l’originalité et de la renommée des créations dans le monde de la mode. Les souliers Louboutin, avec leurs semelles rouges iconiques, continuent de fasciner et de se démarquer grâce à leur singularité reconnue par la justice.
Source : CA Paris, 18 sept. 2024, n° 22/16713

La Cour de cassation a rendu trois arrêts significatifs concernant les contrats de crédit à la consommation. Ces décisions éclairent les conditions dans lesquelles une banque peut être privée de sa créance de restitution du capital prêté, notamment lorsque le vendeur devient insolvable.
La faute de la banque et la restitution du capital
Dans le premier arrêt (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 23-12.122), la Cour de cassation a examiné la faute de la banque qui avait libéré les fonds sur la base d’une simple attestation de livraison signée par l’emprunteur. La banque n’avait pas vérifié la réalisation complète de l’installation des panneaux photovoltaïques. En vertu des articles L. 312-48, L. 312-55 du Code de la consommation et 1231-1 du Code civil, la Cour a rappelé que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, rendant les restitutions dues. Cependant, la banque peut être privée de sa créance de restitution si elle n’a pas assuré la complète exécution du contrat principal, causant ainsi un préjudice à l’emprunteur.
Preuve du préjudice de l’emprunteur
Dans le deuxième arrêt (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 23-11.751), la Cour de cassation a souligné que l’emprunteur doit démontrer un préjudice consécutif à la faute de la banque pour être dispensé de la restitution du capital emprunté. La cour d’appel avait initialement condamné la banque sans caractériser le préjudice en lien causal avec la faute. La Cour de cassation a annulé cette décision, réaffirmant que la faute du prêteur ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
L’insolvabilité du vendeur et le préjudice de l’emprunteur
Le troisième arrêt (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 22-24.754) traite de la situation où le vendeur est en liquidation judiciaire. La Cour de cassation a jugé que l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix auprès du vendeur insolvable constitue un préjudice résultant de la faute de la banque. La banque, en ne vérifiant pas la conformité du contrat principal avant de libérer les fonds, a causé un préjudice à l’emprunteur. Par conséquent, la Cour a confirmé la condamnation de la banque à payer à l’emprunteur une somme correspondant au capital emprunté, à titre de dommages et intérêts.
Ces arrêts de la Cour de cassation mettent en lumière l’importance pour les banques de vérifier la réalisation complète des prestations financées par un crédit à la consommation. En cas de faute de la banque, l’emprunteur peut être dispensé de restituer le capital emprunté, à condition de prouver un préjudice en lien avec cette faute. L’insolvabilité du vendeur constitue un tel préjudice, privant ainsi la banque de sa créance de restitution.
Adresse
3 rue de l’Arrivée,
75015 Paris
Contact
Téléphone : 01 42 18 41 39
E-mail :
contact@brelier-kouame-avocats.com
© 2025 Brelier Kouame Avocats

